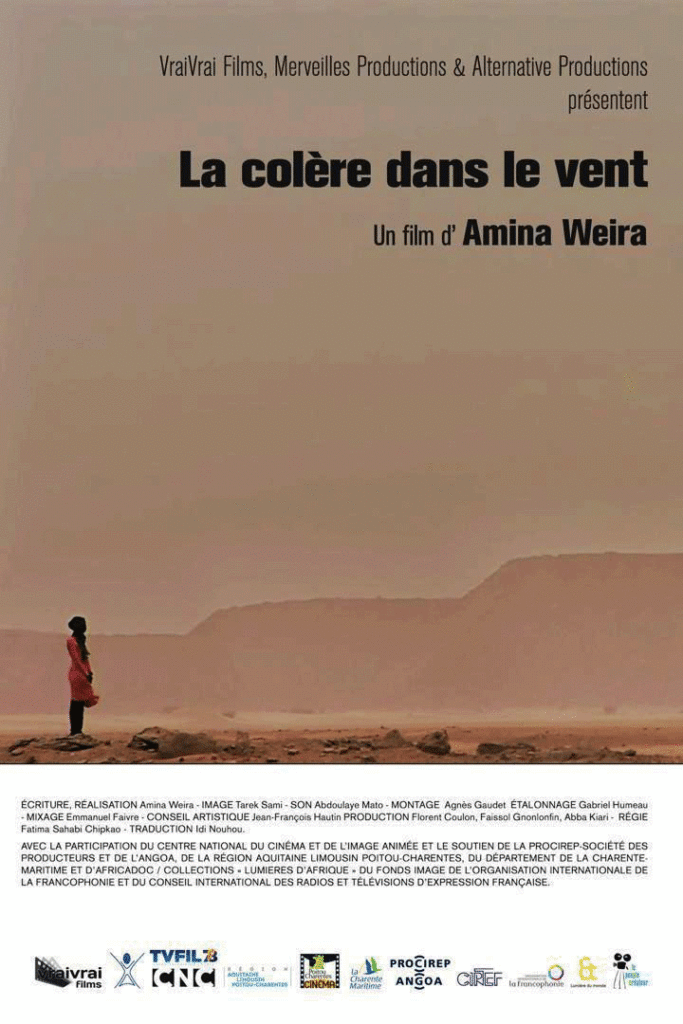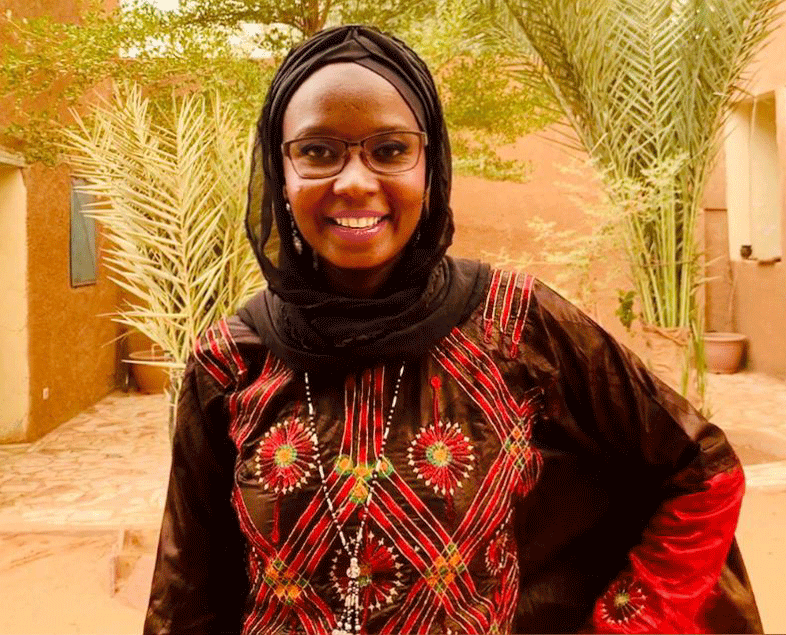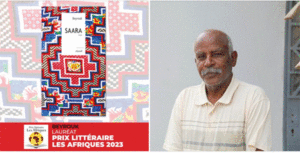Le sacre de la réalisatrice nigérienne, Amina Weira, désignée Pépite d’Or de la sélection 2022 de «Rêve Africain» grâce à son film documentaire, La Colère dans le Vent, remet au goût du jour cette œuvre qui, malgré la marche du temps, est toujours d’actualité. Dans ce documentaire de création de 54 mn, sorti en 2016, produit par Vrai Vrai Films, Merveilles Productions & Alternative Productions, la réalisatrice aborde les préoccupations résultant de l’exploitation de l’uranium dans sa ville natale, Arlit, située au nord du Niger. Une occasion pour revenir sur ce film qui a glané une dizaine de prix au niveau international.
En désignant Amina Weira nouvelle Pépite d’Or de Rêve Africain pour son film documentaire La Colère dans le Vent, les internautes et le jury n’ont pas fait que reconnaitre le talent de la réalisatrice. Ils reconnaissent aussi son engagement et la pertinence du sujet de ce film qui dévoile les dangers liés à l’exploitation de l’uranium.
Avec La Colère dans le Vent, Amina Weira a débarqué sur le terrain de lutte des ONG, des associations, des écologistes ou des spécialistes qui dénoncent les conditions de l’exploitation des ressources minières par les firmes. Elle a braqué sa caméra sur une réalité que vit sa communauté. Fille d’un ancien agent qui a travaillé pendant plus de 30 ans dans les mines d’exploitation de l’uranium d’Arlit, Amina Weira a parmi les principaux protagonistes de son film, son père Mahamane Weira.
Dès le début du film, par choix, la réalisatrice annonce l’objet de sa préoccupation. Le documentaire s’ouvre avec des faibles bruits de vent, de ronronnements de moteur. Suit ensuite un plan général sur le paysage d’une plaine au lever du jour par un temps mi-brumeux. La vue est limitée par des monticules. Puis, apparaissent un peu à contre-champ la réalisatrice et son père en train de marcher. Ils sont à une centaine de mètres de la carrière de la Société des mines de l’Aïr (Somaïr), une entreprise partagée entre la société française Orano (ex Areva) et l’Etat nigérien, créée en 1968. Le Choix des décors n’est pas fortuit, ce qui sera dit dans ce film est lié aux activités qui se passent sur ces lieux. Ce que prouvent déjà les mots de la conversation entre le père et sa fille au sujet de ces montagnes de monticules présentes dans le champ de la caméra. Ce ne sont pas des collines naturelles qui sont filmées, mais les tas des résidus de la mine, apprend-on. A travers les propos de Mahamane Weira, on saisit l’intention de la réalisatrice de focaliser son film sur les problèmes écologiques, la pollution de l’environnement, les effets présumés de la radiation liée à l’exploitation de l’uranium à Arlit.
Réquisitoire à charge
Pour aborder cette délicate question, la réalisatrice use d’une esthétique qui en dit long sur la tonalité du film. La parole est donnée aux anciens ouvriers, aux femmes, aux jeunes, et aussi – chose importante – aux autochtones de la zone, témoins historiques de l’exploitation minière, démarrée il y a une cinquantaine d’années. Avec de poignants témoignages, le film dénonce la situation des anciens ouvriers qui ont du mal à prouver qu’ils souffrent de maladies professionnelles, nonobstant l’ignorance dans laquelle ils ont été maintenus quant aux risques sanitaires liés à leur travail. D’une séquence à une autre, le film évoque les dangers auxquels sont exposés les habitants de la ville qui utilisent, sans le savoir, dans la vie quotidienne, des matériaux et produits qui pourraient être irradiés. On le voit dans les séquences où des objets utilitaires sont fabriqués à partir des tonneaux sortis des mines ; comme l’argile servant à construire les maisons, etc. «À notre arrivée, on ne savait pas que l’uranium contenait des choses dont les effets se répercuteraient jusque sur nos enfants. On a commencé à travailler dans ces conditions sans connaitre les risques, et quand on a appris, on ne pouvait plus faire marche arrière», regrette Mahamane Weira, dans la conversation qu’il tient avec sa fille, au début du film. «Les sociétés minières ne nous laissent que la radioactivité comme héritage», renchérit, avec un peu d’humour, un jeune homme dans une autre séquence du film où la conversation porte sur la compression des agents, les réelles retombées des décennies de l’exploitation de l’uranium pour la ville.
Ceux qui ne travaillent pas dans les mines ont également leur mot à dire. Comme ce vieil autochtone de la zone, témoin de l’installation des mines et de la création d’Arlit. Il parle de trahison en évoquant la pollution qui serait la cause de la mort de ses animaux. La fin de son récit est accompagnée par les notes de l’Inzad jouées par une des femmes autour de lui, dont la beauté n’arrive pas à dissimuler l’inquiétude transparaissant sur leurs visages.
Dans ce film, la réalisatrice a délibérément choisi de donner uniquement la parole à ceux qui sont considérés comme les victimes, les désabusés de l’exploitation de l’uranium, attirés par ce qui était, pour eux, un eldorado. Pas un mot de la société civile d’Arlit très mobilisée sur la question, ni les propos des autorités locales ou administratives, encore moins une intervention d’un responsable des sociétés dont l’activité est incriminée par les protagonistes du documentaire. Il n’y a pas, non plus, dans le documentaire, les images des coins «huppés» de cette ville appelée souvent «Deuxième Paris», une appellation qui en fait sourire plus d’un.
Le filmage des camps où vivent les cadres, les ouvriers des sociétés minières, a tourné court car, interdit en plein tournage, selon la réalisatrice. Tout juste une vue de loin de la cité où elle a passé son enfance. Le documentaire s’est ainsi focalisé sur la partie d’Arlit faite de maisons en banco, là où s’installent les anciens agents.
Ce film est d’un certain point de vue une tribune sur la question de ceux-là qui s’apitoient sur leur sort «comme des oranges sucées et jetées», selon les mots de l’un deux. Ce qui donne à La Colère dans le Vent l’air d’un documentaire à charge. Une œuvre à travers laquelle la réalisatrice affirme : «il est temps que ça change», afin que l’exploitation des ressources minières ou naturelles soit réellement source de développement durable, et surtout d’épanouissement pour les populations locales.
La Colère dans le Vent rappelle dans une certaine mesure les documentaires Le loup d’or de Balolé (1h05mn 2019) de Chloé Aicha Boro sur l’exploitation des carrières de pierres au Burkina Faso et SILAS (80mn 2017) de Hawa Essuman, Anjali Nayar, sur l’exploitation du bois au Libéria et ses conséquences environnementales. Cinq ans après sa sortie, le film documentaire d’Amina Weira n’a rien perdu de son actualité ; bien au contraire ! Ce que corroborent les réactions enregistrées ces derniers temps chez les acteurs concernés par la fermeture, suite à l’épuisement des ressources, le 31 mars 2021, de la mine d’uranium de la Cominak créée en 1974. En effet, la société civile d’Arlit, vent debout, dénonce les conditions ayant conduit à un tel scénario, accusant le géant minier français Orano (ex-Areva) de ne pas avoir tenu plusieurs de ses promesses au moment de la fermeture de la mine.
Souley MOUTARI (Le Sahel)